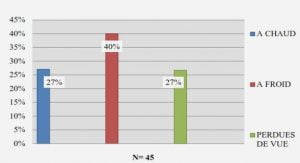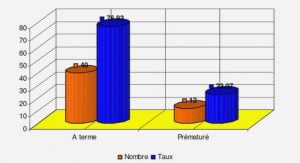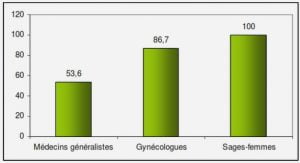Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le sous-système de recherche et études
A partir de l’exploitation d’un ensemble adéquat de dossiers de malades, supposés convenablement enregistrés, on peut pratiquer :
une analyse d’activité des services et départements ;
une étude de la morbidité hospitalière ;
une évaluation de la qualité des soins ;
de la recherche clinique et épidémiologique (exemples : essais thérapeutiques).
Ce sous-système peut alimenter la connaissance médicale qui appartient au sous-système d’action médicale et aux sous-système « administration de l’hôpital » et « planification ».
Le sous-système « logistique »
L’ensemble des prescriptions médicales, issu de chacune des actions médicales, met en œuvre au sein de l’hôpital, un flot d’informations nécessaire au fonctionnement : admissions, transferts, sorties, laboratoires et services techniques, diététiques, pharmacie, archivage des dossiers médicaux, des statistiques de malades hospitalisés, de la facturation :
Toutes ces informations ré-alimentent le dossier du malade et reviennent aussi à l’équipe soignante.
Le sous-système de l’administration
Le sous-système de l’administration quotidienne de l’hôpital inclut :
* la facturation et le recouvrement des créances,
* la gestion, allocation et paye de personnel,
* la gestion des stocks de produit consommables,
* la comptabilité générale et analytique,
* etc…..
Le sous-système de planification
Le sous-système de planification inclut également la gestion et la politique hospitalière. On distingue :
* l’analyse d’activité,
* les études de morbidité hospitalière,
* les décisions concernant les investissements lourds les créations d’unités fonctionnelles,
* les constructions,
* le renouvellement du personnel.
Ce système est alimenté par des informations extra-hospitalières qui proviennent de l’épidémiologie de la population desservie, et des contraintes et incitations financières provenant des autorités de tutelle.
Information médicale et information administrative
Deux notions qui se complètent
L’information médicale et l’information administrative se complètent pour un bon fonctionnement de l’hôpital. On a cherché à opposer ces deux notions, de façon à justifier le choix qui avait été fait dans la politique d’informatisation des hôpitaux publics. Et de cette opposition est née une erreur conceptuelle majeure, qui grève le fonctionnement des hôpitaux.
Certes, la distinction entre ces deux types d’information est claire si on considère qui recueille l’information.
Information médicale
Elle est recueillie par les soignants et comprend :
o les faits et données recueillis sur les malades et décrivant leur santé,
o les actes et les procédures diagnostiques et/ou thérapeutiques effectués sur les malades, ainsi que leurs résultats,
o le corpus de connaissance nécessaire au personnel soignant pour recueillir et interpréter correctement les faits recueillis et les résultats des actes et procédures.
Information administrative
Elle est recueillie par le personnel administratif et comprend :
o les faits et données recueillis sur les malades de nature démographique, financière et sociale.
o Les actes et procédures pratiques.
o Les connaissances nécessaires au recueil et à l’interprétation des faits précédents : ce corpus de connaissances concerne la législation, le droit administratif, la comptabilité, les sciences économiques, le marché des matériels disponibles, etc…
Utilisation et finalité de l’information
La distinction s’effondre si on pense à l’utilisation et à la finalité de l’information. Le médecin ne peut soigner sans utiliser des informations de type administratif : l’âge, la profession, l’ethnie, le lieu d’habitation des malades sont le plus souvent des données pertinentes pour la décision médicale ; il en est de même des données sur le coût des procédures médicales.
Réciproquement, comment gérer un hôpital sans prendre en compte les données et connaissances médicales ? Les négliger c’est oublier la finalité de l’hôpital.
En effet bien gérer un hôpital c’est assurer :
i). Que les actions médicales qui y sont menées le soient de la façon la plus correcte possible (selon des critères nombreux et éventuellement partiellement contradictoires, entre lesquels il faut des compromis ).
ii). Que les données médicales qui y naissent puissent être à l’origine du progrès des connaissances, des procédures et des résultats.
iii). Que la logistique hospitalière soit assurée dans les conditions les meilleures de rapidité, de sécurité, de fiabilité.
iv). Que l’administration (facturation, gestion des matériels et des personnels) fonctionne de façon souple et efficace.
v). Que l’hôpital reste perpétuellement adapté aux besoins de la population à laquelle il est destiné en priorité.
Il est donc abusivement limitatif de réduire la gestion de l’hôpital au point de vue comptable. C’est pourtant la conception qui prédomine encore trop souvent chez les administratifs ou chez les médecins.
C’est cette conception partielle et étriquée qui dominait dans le début des années 1970 quand les systèmes informatiques mis en place l’ont été pour des finalités purement financières et comptables.
Imaginerait-on une usine d’automobiles dont la gestion se limiterait à payer les matières premières et le personnel, à encaisser le produit des ventes, sans se préoccuper de la façon dont sont produites les automobiles, ni du contrôle de leur qualité ?
« C’est à peine une caricature de dire que c’est ainsi que nos hôpitaux ont été gérés jusqu’à un passé récent. ». Ce qui fait à un moment donné le caractère médical ou gestionnaire d’une information, c’est le type de décision qu’elle contribue à induire.
Structuration du dossier médical
Par structuration, on entend ici l’organisation et la présentation du dossier.
Quelques exemples peuvent être donnés.
Structure orientée selon la source
C’est une structure qui suit de la façon la plus « naturelle » l’ordre de l’examen médical. Dans cette organisation, les données obtenues à partir de l’interrogatoire, de l’examen clinique, les examens complémentaires sont regroupées en sections distinctes et successives. Leur fait suite l’élaboration du diagnostic et du pronostic ; et enfin le dossier est conclu par la rédaction du plan thérapeutique. Les données d’évolution sont constituées de sous-ensembles des sections précédentes, c’est-à-dire organisées suivant la même structure que les données recueillies lors de l’examen médical (figure n° 4).
Cette structure « naturelle », parce qu’elle couche par le papier la succession temporelle des démarches et actions médicales, n’est pas sans inconvénients :
□ elle ne permet pas d’expliciter clairement le sens des données. Par exemple, l’interrogatoire regroupe des catégories de données différentes comme les symptômes, les diagnostics ou les traitements antécédents ;
□ la structure orientée selon la source n’est pas stable dans le temps.
Un diagnostic porté à une date donnée devient un antécédent à une date ultérieure ;
□ elle ne fait pas apparaître clairement la notion de stratégie médicale. Un signe est en effet recherché avec telle arrière -pensée diagnostique, un traitement est prescrit avec tel objectif médical… ; autrement dit, la structure selon la source repose très fortement sur l’opposition « faits-interprétation », opposition qui est loin d’être une valeur universelle.
Structure orientée selon les problèmes
Elle est due à L. Weed (“problem oriented medical record”). Elle correspond à une mutation profonde de concepts concernant la structure des dossiers médicaux. La structure qu’il propose vise à faciliter la prise en charge globale des problèmes posés par le patient.
Concept de problème
Le concept de base est en effet celui de problème. C’est un concept plus large que celui de diagnostic, puisqu’il inclut toute condition nécessitant une attention ultérieure, pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance.
Un problème peut être aussi bien un symptôme (exemple : hématémèse, opacité arrondie du poumon), un syndrome (exemple : insuffisance cardiaque globale), un diagnostic déjà établi (exemple : infarctus du myocarde, ulcère du duodénum), une difficulté psychologique ou sociale (exemple : alcoolisme, logement insalubre). Les problèmes peuvent changer au cours de l’observation du malade. Par exemple une hématémèse constitue un problème tant que le diagnostic étiologique n’a pas été effectué. Si un ulcère est découvert, le problème « hématémèse disparaît de la liste, pour faire place au problème « ulcère ». De ce concept dépend directement la structure du dossier médical, conditionnée elle-même par une nouvelle façon de travailler.
Méthode de travail
On peut distinguer 4 étapes :
□ Recueil des données de base.
Cette étape est comparable à l’étape initiale du dossier structuré selon la source.
□ Elaboration de la liste des problèmes.
Il faut lister tous les problèmes somatiques, psychologiques et sociaux du patient.
Chaque problème est indexé par un chiffre, permettant des inférences dans le dossier et des intercalations entre problèmes. La liste est divisée en 2 parties :
□ Les problèmes actifs.
Il s’agit des problèmes actuels et évolutifs (exemple : dépression, hématémèse, diabète non stabilisé, découverte d’une hyperlipidémie, antécédents d’infarctus du myocarde…).
□ Les problèmes inactifs.
Il s’agit des antécédents non évolutifs (exemple : prostatectomie, primo-infection tuberculeuse non évolutive…).
La liste doit, selon Weed, être établie dès l’admission du malade, quitte à ce qu’elle soit modifiée en cours d’évolution. Cette liste doit figurer en tête du dossier.
Chaque problème doit être daté, et documenté selon la logique dite SOAP.
En effet, il faut pour chacun :
Les symptômes Subjectifs qui le concernent,
les signes Objectifs (cliniques, laboratoires, explorations fonctionnelles…),
l’Application médicale (tout commentaire ou remarque sur le problème considéré),
le Plan d’action pour résoudre ou améliorer ce problème (décisions diagnostiques, thérapeutiques, y compris l’éducation sanitaire).
• Plan de travail
Le plan de travail est en effet organisé problème par problème. Il consiste à répondre aux trois questions suivantes :
¨ quelles données nouvelles collecter ?
¨ quel traitement et quelle surveillance mettre en œuvre ?
¨ quel effort d’éducation spécifique faut-il entreprendre ?
ANALYSE DU SYSTEME D’INFORMATION UTILISE A L’HOPITAL GENERAL DE BEFELATANANA
CADRE D’ETUDE
L’étude a été réalisée à l’Hôpital de Befelatanana.
Présentation générale
L’Hôpital Général de Befelatanana est une des composantes du Centre Hospitalier Universitaire ou CHU d’Antanarivo. Il a une double missions :
– dispenser des soins de référence de troisième recours,
– accomplir une mission d’enseignement universitaire.
Il constitue également un champ de stage pour les élèves de l’Etablissement d’Enseignement Médico-Social ou EEMS. Il s’agit d’un Hôpital qui a une vocation purement médicale.
Organisation
L’Organisation de l’Hôpital est définie par son organigramme (figure n° 6)
Une direction de type collégial assurée par une équipe comprend
* Le Directeur.
* Le chef du service des Affaires médicales.
* Le chef du service des Affaires administratives et financières.
* Le chef du service des ressources humaines.
Des instances de concertation représentées par :
* La Commission Médicale d’Etablissement (CME).
* Le Comité du Personnel Non Médical (CPNM).
* Le Conseil Consultatif (CC) instance de décision jouant le rôle de comité de pilotage.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’INFORMATION A L’HOPITAL
1. STRUCTURE DE L’ INFORMATION A L’HOPITAL
1.1. Description des sous-systèmes
1.1.1. Le sous-système d’action médicale
1.1.2. Le sous-système de recherche et études
1.1.3. Le sous-système « logistique »
1.1.4. Le sous-système de l’administration
1.1.5. Le sous-système de planification
1.2. Information médicale et information administrative
1.2.1. Deux notions qui se compètent
1.2.2. Utilisation et finalité de l’information
1.3. Les indicateurs à l’hôpital
1.3.1. Premier groupe
1.3.2. Deuxième groupe
1.3.3. Troisième groupe
2. LE DOSSIER DU MALADE
2.1. Définition
2.2. Structuration du dossier médical
2.2.1. Structure orientée selon la source
2.2.2. Structure orientée selon les problème
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DU SYSTEME D’INFORMATION UTILISE A L’HOPITAL GENERAL DE BEFELATANANA
1. CADRE D’ETUDE
1.1. Présentation générale
1.2. Organisation
1.2.1. Une direction de type collégial assurée par une équipe
1.2.2. Des instances de concertation
1.3. Ressources humaines
1.4. Ressources matérielles et infrastructures
1.5. Les activités et services
1.6. Les ressources financières
2. METHODOLOGIE
2.1. Méthode d’étude
2.2. Paramètres d’étude
2.2.1. Les éléments du système d’information technique
2.2.2. Les éléments du système d’information administrative
3. RESULTATS
3.1. Les éléments du système d’information technique
3.1.1. Le registre des entrées
3.1.2. Le dossier du malade
3.1.3. Rapport d’activités
3.2. Indicateurs administratifs
3.2.1. Le nombre de lits
TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES, DISCUSSIONS ET SUGGESTIONSINTRODUCTION PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’INFORMATION A L’HOPITAL
1. STRUCTURE DE L’ INFORMATION A L’HOPITAL
1.1. Description des sous-systèmes..
1.1.1. Le sous-système d’action médicale
1.1.2. Le sous-système de recherche et études
1.1.3. Le sous-système « logistique »
1.1.4. Le sous-système de l’administration
1.1.5. Le sous-système de planification
1.2. Information médicale et information administrative
1.2.1. Deux notions qui se compètent
1.2.2. Utilisation et finalité de l’information
1.3. Les indicateurs à l’hôpital
1.3.1. Premier groupe
1.3.2. Deuxième groupe
1.3.3. Troisième groupe
2. LE DOSSIER DU MALADE
2.1. Définition
2.2. Structuration du dossier médical
2.2.1. Structure orientée selon la source
2.2.2. Structure orientée selon les problème
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DU SYSTEME D’INFORMATION UTILISE A L’HOPITAL GENERAL DE BEFELATANANA
1. CADRE D’ETUDE
1.1. Présentation générale
1.2. Organisation
1.2.1. Une direction de type collégial assurée par une équipe
1.2.2. Des instances de concertation
1.3. Ressources humaines
1.4. Ressources matérielles et infrastructures
1.5. Les activités et services
1.6. Les ressources financières
2. METHODOLOGIE
2.1. Méthode d’étude
2.2. Paramètres d’étude
2.2.1. Les éléments du système d’information technique
2.2.2. Les éléments du système d’information administrative
3. RESULTATS
3.1. Les éléments du système d’information technique
3.1.1. Le registre des entrées
3.1.2. Le dossier du malade
3.1.3. Rapport d’activités
3.2. Indicateurs administratifs
3.2.1. Le nombre de lits
TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES, DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS
Télécharger le rapport complet