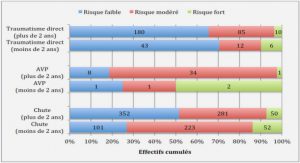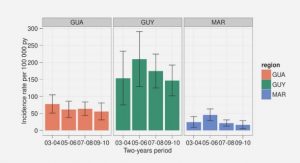Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Caractéristique du projet
Description du landibe
Les chenilles atteignent 8 à 9 cm de long. Elles présentent de grandes variations de couleurs, du gris terne aux couleurs roussâtres teintées blanches. Ces variations se rencontrent sur les chenilles d’une même ponte. Les chenilles sont entièrement velues et portent sur l’anneau antérieur du corps quatre bouquets de piquants entre mêlés de poils fauves.
Les cocons femelles de cette espèce mesurent environ de 5 cm de long sur 3 cm de large. Les cocons mâles mesurent environ 4 cm de long et 2 cm de large. Ils sont bruns et possèdent une pellicule gris argenté, détachable à l’ongle. Selon l’observation de M Duchène, agent de culture, cette pellicule disparaît par la suite (Bulletin du Jardin colonial de septembre 1905. Le landibe de l’Afialy).
Les papillons femelles mesurent 4 cm de long. Il est de couleur café au lait. Leurs ailes antérieures sont traversées de deux rails bruns, la première en arc de cercle au niveau de la linge de séparation du thorax et de l’abdomen et la seconde partage l’aile en deux parties sensiblement égales, elle est droite et parallèle au bord postérieur de l’aile.
Les papillons mâles sont beaucoup plus petits puisqu’ils ne mesurent que deux centimètres et demi de long. Il est brun roux, parfois uniforme mais le plus souvent avec l’aile supérieure partagée en deux zones égales l’une claire, l’autre foncée. La linge de démarcation est parallèle au bord postérieur de l’acte.
Phase de vie du landibe
Pour étudier le landibe, il s’avère difficile de connaître ses mœurs vagabondes, même en cage, mais il suffit de les placer sur des arbres à l’air libre.
Le mois de mars dernier, j’ai effectué une sorte d’expérience afin de démontrer la mode de reproduction des landibe.
Selon la mode indigène, j’ai attaché une femelle avec un bâton et la suspendre sur l’arbuste afin de trouver leur mode de reproduction. Le mâle vole avec facilité et vient féconder la femelle sur le bâton. L’accompagnement a lieu à la tombée de la nuit. La femelle pond le lendemain de 400 à 450 œufs.
Les oeufs sont enclos très régulièrement, dix jours après la ponte. Un jour avant l’éclosion, leur couleur gris change en bleu.
Les landibe muent cinq fois. La durée d’une mue pour une chenille ne dépasse pas une dizaine d’heures. Les graines avaient été pondues le 13 mars. L’éclosion s’est produite le 23 mars.
Le tableau ci-dessous nous montre les différents stades de leur vie ainsi que deux cycles végétatifs par an conditionnés par les variations saisonnières du climat. L’évolution biologique du Tapia en particulier et sans doute des plantes nourricières en générale conditionne donc celle du landibe.
Ennemies et maladie des landibe
En n emi es
Les landibe élevés à l’air libre ont naturellement à subir de nombreuses causes de destruction comme les oiseaux, les grosses araignées. Donc en dehors des oiseaux, dont certaines espèces sont très friandes de chenilles, de nombreux animaux détruisent des quantités considérables de landibe.
Une punaise analogue à la punaise des bois du genre « Pentatoma » envahit le landibe. D’abord de couleur vert bleuté cette punaise après avoir accompli une mue dévient gris rougeâtre. Des indigènes l’appellent « Tsingalan-dandy ». Ils les enlèvent soigneusement sur les arbustes à Landibe car disent-ils cette punaise détruit beaucoup de chenilles. Cependant à deux reprises, les Landibe piqués continuent à vivre et n’ont pas paru incommodés. Il se peut que la mort de la chenille dépende du nombre des piqûres et de l’endroit ou la punaise enfonce son rostre.
M al a di es
Ce sont des maladies incurables. Le seul moyen de lutte c’est la prévention qui consiste à empêcher la population des germes pathogènes par une désinfection systématique locale de l’élevage. Les principaux maladies sont :
– la pébrine,
– la muscardine,
– les flacheries,
– la grasserie.
La pébrine
L’agent de cette maladie est un protozoaire appelé Nosema bombycés. Elle est héréditaire. Il faut donc éliminer les papillons femelles porteurs des spores par un dépistage microscopique.
La muscardine
Cette maladie est très développée pendant la saison pluvieuse. L’observation microscopique montre des différents champignons parasites du bombyx mûri. Apres sa mort, le corps du vers parasité se durcit et devient blanchâtre .
Les fâcheries
Ayant lieu pendant la saison chaude et pluvieuse, elles rendent mous et décomposent le fer après sa mort. Elles peuvent être virales ou bactériennes et favorisées par la malnutrition et l’excès ou l’insuffisance de l’humidité.
La grasserie
Elle est due à un virus appelé borrelina. Les vers affectés de cette maladie se déplacent sans but et quittent la claie pour être tombés par terre où ils tournent en rond et meurent.
La nourriture insuffisante, les feuilles de tapia mal choisies, la mauvaise ventilation, l’humidité excessive sont des principaux facteurs de cette maladie.
ET U DE D U M A RCHE VISE
L’étude de marché est ensemble de méthodes et techniques permettant de recueillir des informations pertinentes et fiables sur une cible visée.
Nous savons que le marché est un lieu de confrontation de l’offre et de la demande.
Elle a pour but d’analyser l’offre et la demande permettant de connaître le marché réel, et de faire apparaître le monde.
Elle a pour but d’analyser l’offre et la demande permettant de connaître le marché réel, et de faire apparaître le mode de commercialisation et de communication sur ce marché.
Analyse de la demande
Situation de la demande
L’estimation de la demande de produit fabriqué en landibe s’appuie essentiellement sur la détermination des effectifs des consommateurs. C’est aussi que nous avons opté pour l’analyse successive :
Analyse du comportement des client Il diffèreselon les ci rconstances .
Le comportement des clients à l’achat diffère d’une catégorie de clientèle à l’autre. Pour les agences de nos produits, les clients feront leurs achats par décision préétablie. Par exemple pour les entreprises artisanales leur décision d’achat dépend de la quantité et qualité des produits à fabriquer. Les autres clients procèdent à l’achat par intérêt et l’envie d’apporter un souvenir de Madagascar.
Analyse qualitative de la demande
El l e r ep os e su r l a m oti v ati on
L’observation est l’une des méthodes efficaces pour étudier la motivation des clients. D’après l’entretien effectué auprès des producteurs de landibe, nous avons pu présenter le tableau ci-après qui montre la tendance générale des clients.
POL IT IQ UE M A R KET I N G ET S TR ATE GIE A A DO PTE R
Le marketing Mix
Le marketing-mix est une politique de marketing pour un produit ou un service, plus précisément pour l’ensemble des produits ou des services vendus par une entreprise. Ce politique comporte quatre catégories de décisions.
Politique de produit :
Elle regroupe toutes les décisions de base relatives aux caractéristiques intrinsèques des produits ou service à offrir à la clientèle : taille et composition de la gamme, caractéristiques fonctionnelles et présentation extérieur de chaque article de la gamme, décision de lancer un produit nouveau, de modifier un produit existant, de cesser de vendre un produit ancien.
En principe, il y a deux objectifs principaux.
Couverture du marché
Le fait d’offrir une gamme plutôt qu’un seul produit est souvent la condition d’une bonne couverture du marché potentiel et par conséquent d’un volume de vente important.
En effet, les besoins, les goûts et les exigences de ce potentiel sont généralement varié. En effet, les clients ne se contenteront plus d’un seul produit.
E q uili b r e d ans l e te m ps d es a cti vit é s e t d e l a r e nt a bil it é
Il consiste à équilibrer autant que possible dans le temps le volume d’activité et la rentabilité de l’entreprise. En effet, une entreprise qui ne vendrait qu’un produit serait très vulnérable aux fluctuations conjoncturelles de la demande ainsi qu’au changement structurel des besoins de sa clientèle.
Pour se prémunir contre ces risques de diminution de la demande, l’unité a intérêt à disposer à tout moment d’une porte feuille de produit susceptible de se relayer mutuellement pour assurer un niveau constant ou même croissant d’activité et de produit.
Politique des prix
Elle concerne le prix de vente des produits ou services de l’entreprise, les différentes considération qui influent sur ces décisions et les principales méthodes que l’on peut utiliser pour les prendre rationnellement.
Elle consiste pour chacun des produits de la gamme à fixer le prix de vente et le prix de cession dans certains cas. La fixation du prix peut être faite, soit suivant la demande de l’acheteur final, soit proportionnel au prix consulté auprès des intermédiaires de la distribution.
L’objectif est de maintenir le marché et de garder la potentialité face à la concurrence ou bien de l’attaquer.
Politique de distribution
On appelle distribution l’ensemble des structures et des démarches commerciales. La distribution se décompose généralement en deux sortes :
– Les canaux de distribution c’est à dire, les circuits parcourus par les biens pour aller du producteur au consommateur.
– La vente en détail, c’est l’interface des canaux avec le consommateur.
Il est à noter que le lambalandy est un bien de consommation de nature impérissable et de moyenne valeur unitaire.
Pour notre entreprise, nous devrons appliquer le canal direct et la vente en détail pour l’écoulement de notre produit.
Politique de communication
Si l’unité veut aller au-delà d’un courant de vente spontané, elle doit concevoir et transmettre des informations sur ses produits, leurs caractéristiques et leurs avantages. De par sa nature même, toute entreprise est un agent de communication.
Il existe quatre grands moyens de communication :
– La publicité,
– La promotion de vente,
– Les relation publiques
– La vente.
La consommation est un ensemble cohérent de services offerts déployés d’une part pour organiser et conduire la campagne de vente et d’autre part pour stimuler les achats des consommateurs et l’efficacité des revendeurs.
Sur ce point, nous optons à une forte campagne publicitaire pour faire connaître nos services car la publicité est une des armes principales dont dispose l’entreprise pour applique sa politique et atteindre ses objectifs.
Pour se faire, des messages et signaux de toute nature seront organisés en direction de nos clients, il s’agit éventuellement :
-d’une installation d’une banderole utile non seulement pour la clientèle résidant mais surtout celle du passage,
– d’un affichage auprès des différents commerçants et des lieux publics,
– d’une distribution des dépliants publicitaires dans les zones accessibles.
Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)
Définition
Le TRI est indiqué par les expressions suivantes « taux moyen de rentabilité » et « taux de rendement du point mort ».
Ce taux consiste à rechercher le taux d’actualisation nécessaire pour obtenir l’égalité entre l’investissement (I0) et la valeur actuelle des recettes attendues, et à ce taux la valeur actuelle Nette (VAN) du projet était nulle.
Interprétation
Le TRI a une signification économique très concrète car, il indique le taux d’intérêt maximum que l’entreprise pourrait supporter dans le cas où la totalité du capital serait empruntée.
Le Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI)
D éf in iti on
Le DRCI est le temps nécessaire au recouvrement du coût initial, autrement dit, c’est le critère de liquidité.
Le critère de décision qui correspond à cet objectif est celui de la période de remboursement.
Elle repose sur le calcul de la période nécessaire pour récupérer la dépense initiale soit en réalisant une économie, soit en dégageant un bénéfice. B) Fo rm ul e∑=MBA i I –n n i(1 )
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : IDENTIFICATION DU PROJET
Chapitre 1 : Présentation du projet
Section 1 : historique du projet
§ 1 – aperçu sur le landibe
§ 2 – description de tissage
§ 3 – analyse de la situation
Section 2 : caractéristique du projet
§ 1 – description du landibe
§ 2 – phase de vie du landibe
§ 3 – ennemis et maladies du landibe
A) ennemis
B) maladies
1- la pébrine
2- la muscardine
3- les fracheries
4- la grasserie
Chapitre 2 : étude du marché visé
Section 1 : analyse de la demande
§ 1 – situation de la demande
A) analyse du comportement des clients
B) analyse qualitative de la demande
C) analyse quantitative de la demande
Section 2 – Analyse de l’offre
§ 1 – les produits
§ 2- distribution des produits
Section 3 – Analyse de la concurrence
§ 1 – les concurrents actuels
§ 2 – les concurrents potentiels
Chapitre 3 – Politique marketing et stratégie à adopter
Section 1 – Le marketing Mix
§ 1 – politique de produit
A)– couverture du marché
B)- équilibre dans le temps des activités et de la rentabilité
§ 2 – politique des prix
§ 3 – politique de distribution
§ 4 – politique de communication
Section 2 Les stratégies marketing à adopter
§ 1 – fixation du prix de vente
§ 2 – les choix de stratégie
Chapitre 4 – Théorie générale sur les outils et les critères d’évaluations
Section 1 – Les outils d’évaluation
§ 1 – la valeur actuelle nette ( VAN )
A)- définition
B)- formule
C)- interprétation
§ 2 – Le taux de rentabilité interne (TRI)
A)- définition
B)- formule
C)- interprétation
§ 3 – Le délai de récupération du capital investit (DRCI )
A)- définition
B)- formule
C)- interprétation
§ 4 – L’indice de profitabilité (IP)
A)- définition
B)- formule
C)- interprétation
Section 2 – Les critères d’évaluation du projet
§ 1 – La pertinence
§ 2 – L’efficacité
§ 3- L’efficience
§ 4 – la viabilité
DEUXIEME PARTIE : CONDUITE DU PROJET
Chapitre 1 – Technique de production
Section 1 – Gestion du risque
§1 – maîtrise technique
§2 – maîtrise du temps
§3 – maîtrise des coûts
Section 2 – Technique de production envisagée
§1 – technique de production de cocons
§2 – les arbres « tapia » et les matériels
A) Insuffisance des tapia
B) Insuffisance des matériels
Section 3 – Technique de tissage et confection de landibe
§ 1 – Principe de production
§ 2 – Processus de production
Chapitre 2 – Capacité de production envisagée
Section 1- Les moyens de production
§ 1- Moyens humains
§ 2 – Moyens matériels
§ 3 – Moyens financiers
Section 2 – Description de la production envisagée et planning de vente
§ 1 – La production envisagée
A) Liste de produits
B) Production envisagée
§ 2 – Planning de vente
A) Evolution de prix des produits
B) Chiffre d’affaire pendant les cinq ans d’exploitation
Chapitre 3 – Etude organisationnelle
Section 1- Organisation administrative
§ 1 – Organisation juridique
§ 2 – Statut juridique
Section 2 – Organisation des ressources humaines
§ 1 – Attribution du personnel
A) Le Gérant
B) Service production
C) Service comptable
D) Service commercial
E) Dessinateur
F) Chauffeur
G) Femme de ménage
H) Sécurité
Section 3- Gestion de personnel
§ 1 – Politique salariale
§ 2 – Politique de formation du personnel
§ 3 – Politique de motivation
§ 4 – Organigramme à mettre en place
TROISIEME PARTIE : ETUDE FINANCIERE DU PROJET SELON LE PCG 1987
Chapitre 1 : Les investissements nécessaires et le compte de gestion
Section 1- nature et coût des investissements
§ 1 – Les immobilisations
A) Immobilisations incorporelles
B) Immobilisations corporelles
1- terrain
2- matériels et outillages
3- agencement, aménagement et installations
4- matériels et mobiliers e bureau
5- matériels informatiques
6- coût du matériel de transport
7- récapitulation des immobilisations
Section 2- Planning de financement
§ 1 – Le crédit d’investissement
§ 2 – Le crédit de fonctionnement
Section 3 – Le tableau des amortissements
§ 1 – Définition de l’amortissement
§ 2 – Calcul de l’amortissement
Section 4- Tableau de remboursement des dettes
Section 5- Fonds de roulement initial
Section 6- Compte de gestion
§ 1 – Compte des charges
A) Les achats des matières premières
B) Les achats de marchandises
C) Les fournitures consommables
D) Matières et fournitures non stockées
E) Charges externes
F) Impôts et taxes
G) Charges du personnel
H) Dotation aux amortissements
I) Récapitulation des charges
§ 2 – Compte de produits
Chapitre 2- Etude de faisabilité et analyse de rentabilité
Section 1- Le compte de résultats prévisionnels
Section 2- Tableau de grandeur caractéristique en gestion
Section 3- Plan de trésorerie
Section 4- Bilan prévisionnel
§ 1 – Bilan prévisionnel de la première année
§ 2 – Bilan au 31/12 de l’année 2
§ 3 – Bilan au 31/12 de l’année 3
§ 4 – Bilan au 31/12 de l’année 4
§ 5 – Bilan au 31/12 de l’année 5
Chapitre 3- Evaluation et impact du projet
Section 1- Evaluation économique
§ 1 – Notion de la valeur ajoutée
§ 2 – Ratios de performance économique
Section 2- Evaluation financière
§ 1 – Selon les outils d’évaluation
A) La valeur actuelle net (VAN)
B) Le taux de rentabilité interne (TRI)
C) Le Délai de récupération des capitaux investis(DRCI)
D) L’indice de profitabilité (IP)
§ 2 – Selon le critère d’évaluation
Section 3- Evaluation sociale
§ 1 – Création d’emploi
§ 2 – Développement de la région
CONCLUSION GENERALE
Télécharger le rapport complet