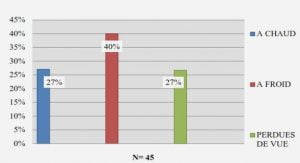La collectivité territoriale
La collectivité territoriale ou collectivité locale est une portion du territoire d‟un Etat doté d‟une certaine autonomie de gestion. Elle est une structure administrative distincte de l‟Etat qui a en charge les intérêts de la population de son territoire. Elle est dotée d‟une personnalité morale, de la libre administration et d‟une assemblée de délibération. Son administration est exercée par un conseil municipal sous la direction d‟un maire. Le code des collectivités locales du Sénégal à son article 77 dit : » la commune est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle regroupe les habitants du périmètre d‟une même localité unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la nation ». Elle est constituée sur une zone géographique clairement définie. Au Sénégal, la commune est la plus petite échelle de l‟organisation territoriale. La collectivité locale est au cœur des stratégies visant à promouvoir des modes de vies sains et le dynamisme des populations. Elles ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d‟intérêt local. La collectivité locale, dans l‟exercice de ses fonctions, rencontre des difficultés. Parmi cellesci, la formation des élus et le manque de moyens financiers sont souvent évoqués. Avec le renforcement de la décentralisation, les communes bénéficient de la possibilité de développer des partenariats avec d‟autres acteurs de développement.
Gouvernance alimentaire
Le développement de la gouvernance alimentaire pose la question de la production, de la consommation, et par ce biais de l‟organisation de la société. Toutes les dimensions de l‟alimentation sont prises en comptes : agriculture, santé publique, environnement, lien social, économie et emploi. Les enjeux sont multiples : inciter à améliorer le régime nutritionnel, modifier le comportement en informant, réorganiser les chaînes de production et de commercialisation etc. La clé sera la capacité à fédérer les acteurs : agriculteurs, transformateurs, distribution, société civile, pouvoirs publics, pour penser et réaliser les évolutions nécessaires. La gouvernance alimentaire territoriale désigne un nouvel ensemble de coopérations entre les différents acteurs et les échelons d‟intervention géographiques, dont l‟objectif commun est la satisfaction des besoins alimentaires de toutes les populations. La notion de « gouvernance alimentaire » intègre les traditionnelles politiques liées au développement des circuits de proximité pour les inscrire dans un cadre plus large d‟aménagement et de développement durable du territoire, englobant les enjeux économiques et de gestion de l‟espace mais aussi les enjeux sociétaux de santé publique, le défi environnemental, l‟accès social, la nutrition ou encore la culture et l‟identité du territoire.
Sécurité alimentaire
Le terme « sécurité alimentaire » a été énoncé au début des années 40, pendant la seconde guerre mondiale selon le comité de la sécurité alimentaire mondiale. En 1943, 44 gouvernements résolument tournés vers l‟avenir se sont réunis à Hot Springs, en Virginie (États-Unis), pour examiner l‟objectif de mettre l‟humanité à l‟abri du besoin, vu sous l‟angle de l‟alimentation et de l‟agriculture. Ils sont arrivés à la conclusion que pour « vivre à l‟abri du besoin », chaque homme, chaque femme et chaque enfant devait disposer de provisions alimentaires sûres, suffisantes et appropriées, « sûres » renvoyant à l‟accessibilité des produits alimentaires, « suffisantes », à la quantité de nourriture disponible et « appropriées », à la teneur en nutriments des aliments. L‟organisation des nations unies pour l‟alimentation et l‟agriculture, lors de son sommet mondial de l‟alimentation en 1996, affirme que : » la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». Cette définition renferme des aspects liés l‟alimentation et aux pratiques de soins pour une bonne nutrition. Le guide pratique de la FAO extrait du cours de formation à distance « Les concepts et les cadres de la sécurité alimentaire » présente les quatre dimensions de la sécurité alimentaire :
La disponibilité alimentaire : Cette dimension renvoi à l‟adéquation entre l‟offre et le demande. Elle est assurée soit par la production locale soit par les importations commerciales soit par les aides commerciales. Les besoins alimentaires sont couverts tant du point quantitatif que qualitatif.
L‟accessibilité alimentaire : Cette dimension renvoi aux capacités de la population de se procurer des aliments. En effet la disponibilité peut être suffisante alors certaines personnes n‟arrivent pas à s‟alimenter. Les difficultés d‟accessibilité peuvent être physiques ou économique. L‟aspect physique renvoi à l‟enclavement du territoire, aux difficultés d‟approvisionner les marchés. L‟autre aspect est lié au pouvoir d‟achat. Certaines personnes peuvent ne pas disposer de ressources pour produire ou acheter les aliments dont elles ont besoins.
La stabilité alimentaire : La disponibilité de l‟alimentation ainsi que son accessibilité doivent être préservé de manière stable dans le temps. La nourriture doit être assuré dans le temps (d‟une période à une autre) et dans l‟espace (d‟une région à une autre). La sécurité alimentaire doit être durable.
L‟utilisation alimentaire : Cette dimension porte sur la façon dont la population utilise la nourriture. Le régime alimentaire, la préparation des aliments, les pratiques d‟hygiène ont pour résultat un apport adéquat énergie et en nutriments
Les lieux d‟approvisionnement des populations
Les marchés classiques sont les espaces les plus utilisés par les ménages. Les raisons évoquées sont souvent le niveau des prix qu‟ils considèrent moins chers comparés aux grandes surfaces. Les produits, les plus utilisés, sont le riz ordinaire local et importé, savon de ménage, huile, lait en poudre, sucre cristallisé, pain, farine de blé, oignon, concentré de tomate, des légumes à base locale frais dans sa large diversité etc. Ces produits sont aussi vendus dans les grandes surfaces (mais pas dans le même état) en plus avec des produits transformés locaux et importés. En effet, l‟importance du secteur informel dans les collectivités locales de Grand Yoff et Ngor est directement liée à la faiblesse du pouvoir d‟achat. En effet, ils préfèrent généralement acheter les vivres de base les moins chers, distribués avec un minimum de valeur ajoutée, de qualité et de diversité. Le système de distribution des grandes surfaces est souvent laissé à des consommateurs dotés d‟un pouvoir d‟achat élevé même si les catégories sociales plus modestes peuvent y voir leur compte. Elles proposent une gamme plus large de produits que les détaillants et de meilleure qualité d‟hygiène, de service, de stabilité des prix, chaine de froid pour les produits périssables etc.). Les boutiques de quartiers sont le mode distribution dominants. Leurs prix ne sont pas moins élevés mais elles offrent des services aux consommateurs (durée d‟ouverture, proximité, crédits) que ne peuvent offrir les autres distributeurs. L‟envergure du marché castor, son stock important de marchandises ainsi que ses bons prix attirent la population de Grand Yoff et même celle de la commune de Ngor. La catégorie socioprofessionnelle influe sur le choix du lieu d‟approvisionnement. Les marchés font un peu l‟exception car toutes catégories confondues les utilisent pour acheter des aliments. Les supermarchés sont plus fréquentés par les cadres et chefs d‟entreprises. Les pécheurs, les ouvriers et les inactives n‟utilisent relativement pas les supermarchés.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : LA GOUVERNANCE ALIMENTAIRE DANS LES COMMUNES DE GRAND YOFF ET NGOR
CHAPITRE I : LES ASPECTS DE L‟ALIMENTATION DANS LES COMMUNES DE GRAND YOFF ET DE NGOR
CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES COMMUNES DE GRAND YOFF ET NGOR
DEUXIEME PARTIE : LES ACTEURS DE LA GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
CHAPITRE III : LES AUTORITES PUBLIQUES
CHAPITRE IV : LES AUTRES ACTEURS NONS ETATIQUES
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet