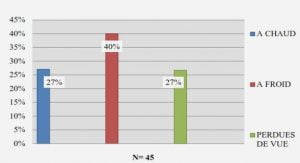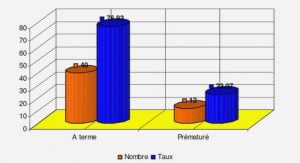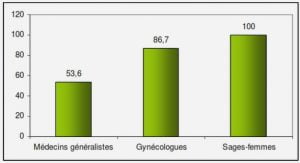Les lubrifiants sont des matériaux qui sont toujours présents dans les contacts entre deux solides, ce sont soit des solides, soit des liquides, ou des gaz. Par leurs écoulements, ils contrôlent le frottement, les usures et les contacts entre les deux solides où ils sont interposés, opposant une faible résistance au cisaillement. Les principaux types de lubrifiants sont: les lubrifiants liquides, les graisses, les lubrifiants solides et les lubrifiants semi solides ou plastiques.
Les huiles lubrifiantes
Les huiles lubrifiantes actuellement utilisées, sont généralement constituées d’un fluide de base appelé « base lubrifiante » qui peut être soit d’origine minérale, soit d’origine synthétique. Les bases minérales sont obtenues directement à partir du fractionnement du pétrole alors que les bases synthétiques sont produites grâce à la transformation de composés organiques provenant du pétrole, auquel sont ajoutés de nombreux additifs dont la nature varie avec la destination du produit.
Les bases minérales
Les bases minérales sont généralement obtenues par distillation et raffinage de pétrole brut, quelques bases sont hydro-traitées ou hydro-craquées, pour améliorer certaines de leurs propriétés telles que la couleur, la résistance à l’oxydation, la stabilité thermique ou la viscosité. Selon l’origine du lubrifiant, les bases minérales peuvent être classées en deux étapes:
– Les bases à structures parffiniques continnent de longues chaînes droites hydrocarbonées saturées. Ces bases présentent une grande stabilité à l’oxydation, et un indice de viscosité très élevé, donc elles sont généralement préférées.
– Les bases à structures naphténiques : elles sont formées de noyau cycliques. Ces bases sont moins stables à l’oxydation et présentent un indice de viscosité moins élevé (de l’ordre de 50) et leurs point d’écoulement plus bas. Elles possèdent par contre d’excellentes caractéristiques d’écoulement à basse température.
Les bases synthétiques
Elles sont produites par des réactions telles que l’alkylation, la polymérisation et l’estérification, elles incluent des hydrocarbones synthétiques (alkyloromatique et polyster), des esters organiques (esters d’acide dicarboxylique, esters de polyol et polyster) et divers autres produits organiques (ester de polyphate polyalkylène glycol). A l’origine, les bases synthétiques ont été développées pour remplir le manque temporaire d’huile minérale naturelle sur les marchés internationaux et résoudre des problèmes de lubrification particulièrement difficiles, on peut citer comme exemples les fluides de haute stabilité thermique, les fluides difficilement inflammables et les lubrifiants pour l’aviation. Parmi les principales familles de produits utilisés, on mentionnera:
– Les esters aliphatiques qui se caractérisent par un indice de viscosité élevé, une faible volatilité et des propriétés lubrifiantes excellentes.
– Les esters phosphoriques utilisés souvent comme additifs anti-usure, qui présentent un indice de viscosité élevé et sont difficilement inflammables.
– Les silicans et silicates qui ont un excellent indice de viscosité et un point d’écoulement très bas.
– Les polyphénylithers qui présentent une remarquable stabilité à haute température (jusqu’à 450°) et qui sont d’excellents lubrifiants, ils ont cependant un indice de viscosité faible.
– Les polypropylènes glycols qui se caractérisent par un indice de viscosité élevé, un point d’écoulement très bas et de bonnes propriétés anti-usure, cependant ils ont une stabilité thermique et une résistance à l’oxydation assez moyenne et certains ne sont pas mixibles aux bases minérales.
– Les polyoléfines qui présentent un indice de viscosité assez élevé et un point d’écoulement très bas.
Tous les produits utilisés en mélange avec d’autres bases synthétiques ou minérales.
Additifs ou dopes
Les propriétés de bases utilisées sont généralement modifiées par les composés de structures chimiques très variées, appelés additifs ou dopes.
Additifs détergents et dispersants
Ces additifs permettent d’une part de maintenir les parties les plus chaudes d’un moteur en bon état de propreté en évidant les dépôts, c’est l’effet détergent et d’autre part, de maintenir en suspension les impuretés solides formées au cours du fonctionnement du moteur afin d’éviter la formation d’agglomérats, c’est l’effet dispersant, par ailleurs, ces additifs généralement basiques neutralisent les composés acides formés par la combustion. L’action de ces additifs s’effectue essentiellement par adsorption sur les surfaces métalliques afin d’éviter l’adhérence des dépôts et par adsorption sur les particules en suspension dans l’huile pour maintenir leur dispersion. Les produits utilisés sont soit des organo-sels de métaux alcolino terreux tels que les sulfonâtes, les théophosphates et les phénat, soit des succins imides plutôt utilisées comme dispersants.
Additifs améliorant d’indice de viscosité
Ce sont des polymères qui, introduits à faible concentration dans une base lubrifiante entraiennt une augmentation relative de la viscosité plus importante à haute qu’à basse température et qui, par conséquent augmentent l’indice de viscosité du lubrifiant sans modifier défavorablement les autres propriétés essentielles. Les produits généralement utilisés sont des polyméthacrylates, des polycrylates et des polymères d’oléfines. Il faut cependant mentionner que ces polymères utilisés comme additifs ont des masses moléculaires élevées et sont relativement fragiles, ils peuvent se dégrader d’une part sous l’effet de sollicitations mécaniques telles que les contraintes de cisaillement, par rupture de la molécule et d’autre part sous l’effet de température soit par thermo oxydation soit par dépolymérisation.
Additifs de point d’écoulement
A basse température, le cisaillement des paraffines modifie les propriétés rhéologique du lubrifiant qui tend à solidifier, les additifs de point d’écoulement sont donc utilisés pour lutter contre la solidification, ils agissent sans doute par absorption en diminuant la taille des cristaux de paraffine, ou en modifiant la forme cristalline qui évolue vers une structure en aiguilles et en réduisant l’adhésion entre les cristaux. Les produits utilisés appartiennent aux quatre familles suivantes alkyl aromatiques, les posters, les polyamides et les polyléfines.
Additifs anti-oxydants
Ces produits ont pour rôle de ralentir et si possible de supprimer les phénomènes d’oxydation du lubrifiant, ils agissent de très différentes façons :
– Par blocage du processus des destructions en captant les radicaux libres des chaînes moléculaires, ces produits sont généralement des phényles et des amines.
– Par désactivation des peroxydes qui se forment lors du phénomène de détérioration, ces composés sont des dithiophosphates et des dithiocardamates.
– Par désactivation des ions métalliques et par formation d’un film protecteur sur les surfaces afin d’éliminer l’action catalytique des métaux, ces additifs sont des phénates.
L’anti-usure
Les additifs Extrêmes Pression (EP) et anti-usure sont employés pour former un film protecteur sur les surfaces métallique, presque toutes les formulations modernes se basent sur l’utilisation des ZNDTP pour la réduction de l’usure, mais ils servent aussi à empêcher l’oxydation et la corrosion, ces additifs sont synthétisés par réaction d’un alcool, ou d’un alkyl phénol, avec un penta sulfure de phosphore ce qui produit un acide neutralisé par l’oxyde de zinc et conduit à des sels de zinc.
L’anti-mousse
Dans la plupart des applications, les lubrifiants sont agités, ce qui provoque la formation de bulles d’air et de mousse, un moussage excessif de l’huile entraîne des défauts de lubrification et une oxydation précoce. [17] Alors on doit utiliser les additifs anti- mousse qui réduisent le moussage en diminuant la tension de surface du fluide et en facilitant la séparation des bulles de la phase liquide, ces additifs sont très peu solubles dans l’huile et sont donc présents en très petites quantités. Les produits employés comme anti-mousse sont des silicones tels que le polydiméthylsiloxame (PDMS), ou des polyalkylméthacrylates (PAMA).
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES ROULEMENTS
I. Introduction
I.1. Composition
I.1.1. Désignations
I.3. Charges supportées par les roulements
I.3.1. Direction des charges
I.4. Principaux types de roulements
I.5. Nature des efforts
I.5.1. Conditions de fonctionnement
I.6. Assemblage d’un roulement
I.7. Choix du roulement
I.8. Calcul des efforts extérieurs
I.9. Capacité de charge des roulements
I.10. Calcul des charges sur les roulements
I.11. Charges équivalentes
I.12. La lubrification
I.13. Conclusion
CHAPITRE II : LES HUILES LUBRIFIANTES
II.1. Introduction
II.2. Les huiles lubrifiantes
II.2.1. Les bases minérales
II.2.2. Les bases synthétiques
II.3. Additifs ou dopes
II.4. Viscosité des lubrifiants
II.5. Viscosimètres
II.5.1. Les viscosimètres absolus
II.5.2. Les viscosimètres empiriques
II.6. Spécification des lubrifiants
II.7. Les graisses lubrifiantes
II.7.1. Types de graisses
II.7.2. Graisses sans savons
II.8. Conclusion
CHAPITRE III : RHEOLOGIE DES HUILES LUBRIFIANTES
III.1. Introduction
III.2. Fluides visqueux non linéaires
III.3. Fluides visco-élastiques
III.4. Fluides viscoplastiques
III.5. Fluides polaire ou avec couple des contraintes
III.6. Conclusion
CHAPITRE IV : LUBRIFICATION DES ROULEMENTS
IV.1. Introduction
IV.2. Lubrification à la graisse
IV.2.1. La soupape à graisse
IV.2.2. La pompe à graisse
IV.3. Lubrification à huile
IV.3.1. La lubrification à bain d’huile
IV.3.2. Bague de remontée d’huile
IV.3.3. Par circulation d’huile
IV.3.4. Lubrification à jet d’huile
IV.3.5. La lubrification air-huile
IV.3.6. Graissage par brouillard d’huile
IV.4. Mode de lubrification
IV.5. Graissage et entretien des roulements
IV.5.1. Intervalles de graissage
IV.5.2. Mode d’action des lubrifiants
IV.5.3. Graissage visqueux ou hydrodynamique
IV.6. Conclusion
CHAPITRE V : ETUDE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE D4UN FILM D’HUILE DANS UN ROULEMENT A BILLES
V.1. Introduction
V.2. Lubrification élastohydraudynamique
V.2.1. Théorie de EHD
V.3. Les paramètres du EHD
V.4. Avaries dans les contacts EHD
V.4.1. Micro écaillage
V.4.2. Ecaillage
V.4.3. Grippage
V.4.4. Des empreintes des corps roulants
V.4.5. La corrosion
V.4.6. La coloration
V.4.7. La corrosion en contact
V.4.8. Des empreintes des particules
V.4.9. Usure
V.5. Analyse des résultats
V.6. Conclusion
Conclusion générale