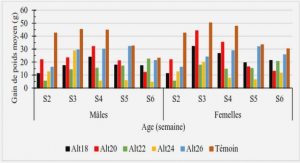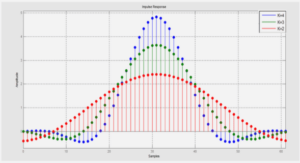Déconcentration
La déconcentration, signifie que l’Etat central garde ses pouvoirs et responsabilités pour une fonction spécifique, mais fait exercer et exécuter cette fonction en dehors de la capitale par des antennes ou bureaux de l’administration situé en région. Un tel système peut être mis en place par la responsabilisation des gouverneurs ou préfets dont les bureaux se situent en dehors de la capitale, ou par la création de directions régionales ou préfectorales de ministères ou par les deux mécanismes, ce qui soulève alors des questions de coordination et de partage d’autorité. L’important est que les fonctionnaires et cadres situes en région puissent prendre des décisions sans en référer à la capitale et ne soient pas de simples courroies de transmission. Le terme déconcentration peut être mini comme étant la répartition territoriale des taches, permettant de régler le plus rapidement possible les problèmes dont s’occupe l’administration, grâce, notamment, à une compréhension plus directe des conditions locales par les organes déconcentrés disposant de la compétence de décision. La décentralisation territoriale, comme il l’appelle, signifie : « Un transfert d’un pouvoir de décision ou d’une responsabilité d’exécution à une entité administrative au sein de la même personne morale ». Ainsi, les organes centraux restent compétents pour l’orientation générale et pour la coordination. Suivant ces principes, leurs compétences comprennent l’orientation générale, la coordination et le contrôle des organes déconcentrés. Cependant, ce sont les organes déconcentrés qui bénéficient de la présomption de compétence, dans la mesure où ils disposent de la compétence de décision générale sur les affaires de leurs circonscriptions, les organes centraux se limitant aux compétences qui leur sont attribuées par des dispositions spéciales qui se rapportent a un objet précis. Les principes de la déconcentration reçoivent, sous des formes diverses, une reconnaissance constitutionnelle.
Première République
La première république de 1960 à 1972
La décentralisation sous la première république avait avant tout pour objectif de rendre plus efficace l’exécution du plan et la prestation de services publics, en exploitant l’avantage d’information disposée au niveau local, ainsi que l’existence de ressources humaines locales. Les préfectures se sont vite révélées comme le niveau idéal de planification régionale. Les collectivités (les communes et les provinces) étaient fortement encadrées par l’Etat et leurs initiatives étaient soumises à un contrôle à priori. Le contexte de l’époque était caractérisé par une forte capacité de l’administration fiscale de proximité à collecter des impôts et les communes bénéficiaient des ristournes et des centimes additionnels qui constituaient environ 67% des recettes communales, et seulement 33% provenaient des transferts, alors que pour les communes actuelles, les transferts représentent (80%) des recettes des communes rurales. On peut conclure que la décentralisation de la première république traitait principalement l’aspect exécution du plan et du budget : une centralisation des décisions et réflexions politiques et une décentralisation maximale des exécutions à la base.
La première république de transition de 1972 à 1975
L’institution des fokonolona pendant la période de transition a mis la question de la légitimité du pouvoir politique au cœur des réformes ,puisque la légitimité viendrait cette fois-ci de la base même, et d’autant plus que le fokonolona ou la communauté villageoise de base est bien ancré dans la tradition historique et culturelle Malagasy .On peut citer parmi ces valeurs culturelles le teny ierana ou littéralement la concertation et le dialogue.
Appréciation de la décentralisation
La décentralisation est un système qui ne présente pas que des avantages :
Avantage : C’est un facteur de bon fonctionnement de l’Administration. Les décisions administratives prises à l’échelon local par des autorités locales élues, par exemple, correspondent d’avantage aux besoins des administrés que les décisions prises par un pouvoir central lointain et plus ou moins informé. Ces décisions interviendront, en outre rapidement et pourront s’appliquer sans difficulté sous le contrôle permanent des autorités décentralisées. C’est un facteur de libéralisme : elle permet le libre exercice sur le plan local des libertés politiques (droit de vote) ; elle peut donc être considérée comme une école de démocratie : elle assure au peuple une participation effective aux affaires publiques et l’habitue à s’occuper des affaires de l’Etat. C’est un facteur de décongestion des capitales à une époque où celles-ci ont tendance à concentrer tous les éléments moteurs de la nation, contribuant ainsi au déséquilibre qui existe entre elles et le reste du pays.
Inconvénients : La décentralisation affaiblit le pouvoir central, multiplie ce que les Anglo-Saxons appellent les contrepouvoirs, empêche une action administrative concertée et harmonieuse. Chaque collectivité décentralisée ayant l’initiative en matière d’affaires locales, il peut en résulter un certain désordre. La décentralisation accorde la primauté aux intérêts locaux. Or, l’intérêt général et les intérêts locaux peuvent ne pas exactement correspondre. La décentralisation peut être une source de gaspillage financier : les structures des collectivités décentralisées sont souvent lourdes et leurs dépenses incompréhensibles, les subventions de l’Etat sont alors nécessaires, mais elles contribuent à entretenir les collectivités en état de déficit permanent, qui ne justifient pas les services rendus.
Principe et cadrage du PRD
La base de la définition des axes stratégiques du PRD 2007 est toujours les principes directeurs que la Région Analamanga a défini lors de l’élaboration de l’ancien PRD dont le cadrage est la vision Madagascar naturellement, portant sur l’horizon 2015. Ces principes directeurs sont au nombre de trois dont entre autre :
La participation active citoyenne : La région est convaincue que l’appropriation par la population est nécessaire dans la durabilité de la réalisation. Ainsi, l’implication des acteurs dans le mécanisme de prise de décision et clarification de décision au citoyen sont nécessaires. Ce principe est la base même du développement local.
L’intégrité des actions : qui n’est autre que l’application des normes de la bonne gouvernance dans l’allocation des ressources et dans tout le mode opératoire des responsables à tous les échelons. Ce second principe est le fondement du développement économique d’un pays.
Le partenariat soutenu : l’ambition de la croissance économique de la Région Analamanga passe par le renforcement et la diversification de ses partenaires dont les premiers partenaires sont les leaders traditionnels et les élus locaux.
Renforcement des capacités au niveau local
o Appui à la planification de développement local et régional participative (Plans Communaux de Développement et Plans Régionaux de Développement) ;
o La facilitation de la mise en œuvre des plans ;
o Appui à l’élaboration des outils de référence à l’intention et usage des acteurs de développement et de gouvernance locale ;
o Appui à la mise en place des structures locales composées souvent de plusieurs acteurs de développement local ;
o Renforcement des capacités des élus locaux (équipe de l’Exécutif et organe délibérant) et des autres entités de gouvernance locale.
Dans tous ces exercices, les acteurs de la gouvernance locale tels que les représentants de la société civile et du secteur privé ainsi que les représentants de l’Etat et des élus ont été sensibilisés, redynamisés et responsabilisés. En particuliers, le PNUD a organisé des ateliers sur des thèmes tels que la planification participative, la gestion financière, la suivi-évaluation des plans de développement, et la gestion efficace des ressources humaines. Cependant, beaucoup restent à faire quant à l’effectivité de la décentralisation à Madagascar requérant:
o Assurer l’effectivité des textes sur les compétences des CTD vis-à-vis des STD, ainsi que celle sur les attributions des STD vis-à-vis des CTD ;
o Veiller à ce que les procédures soient transparentes efficaces et efficientes ;
o Intensifier la mise en œuvre de programme de recyclage des CTD dans le cadre du plan de formation ;
o Renforcer les capacités de maitres d’ouvrage des CTD ;
o Etudier et initier la mise en place d’un fonds commun de renforcement des capacités pour le financement de la formation, de la mobilisation d’experts, de la capitalisation par des échanges, de la vulgarisation des informations, de l’affinement itératif de manuels de procédures et de guides ;
o Développer et renforcer les mécanismes d’opération et de maintenance du patrimoine public local, régional et provincial ;
o Systématiser le recours aux méthodes modernes de gestions des ressources (humaines, financières, matérielles, informationnelles).
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
INTRODUCTION
PARTIE I : CONCEPT SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LA DECENTRALISATION
Chapitre I : Approche théorique du développement local
Origine
Au niveau International
Idée générale
Concept sur le développement local
Notion du développement
Développement économique
Développement durable
Notion de local
Origine
Utilisation généralisée
Développement local
Définition
Différence entre développement économique local et développement local
Les principales composantes du développement local
Les modalités du développement local
L’essence du développement local
Développement local et régional
Développement local et la mondialisation
Motif et justification du développement local
Les principes de base et l’idée de base du développement local
Principes de base
L’idée de base
Les domaines d’interventions du développement local
Les avantages concurrentiels locaux
Chapitre II : Concept sur la décentralisation
Définitions
Décentralisation
Déconcentration
Développement local et décentralisation vu à travers le Plan Régional de Développement
Délégation
Dévolution
Historique de la décentralisation à Madagascar
Première République
La première république de 1960 à 1972
La première république de transition de 1972 à 1975
Deuxième République
La seconde république de 1975 à 1990
La seconde République de 1990 à1992
Troisième République
La troisième République : première partie 1992 -1998
La troisième République :deuxième partie 1998-2007
La troisième République :troisième partie 2007- 2010
Quatrième République
Les différentes dimensions de la décentralisation
Décentralisation politique
Définition
Quelles sont les principales composantes ?
Décentralisation Administrative
Définition
Quelles sont les principales composantes ?
Décentralisation fiscale
Définition
Quelles sont les principales composantes ?
Différentes formes et appréciation de la décentralisation à Madagascar
Formes de la décentralisation
La décentralisation territoriale et la création de collectivités territoriales décentralisées
La décentralisation par services et la création d’établissements publics
Les formes intermédiaires
Appréciation de la décentralisation
Avantage
Inconvénients
Les Régions
Développement local et décentralisation vu à travers le Plan Régional de Développement
Quelles sont les différents acteurs des Régions ?
Organe délibérant et ses attributions
Cadre juridique
Composition du bureau
Attributions de l’organe délibérant
Organe exécutif et ses attributions
Cadre juridique
Composition du bureau
Attributions de l’organe exécutif
Compétence
PARTIE II : Analyse de liens entre la développement local et la décentralisation
Chapitre III : Décentralisation concerne les axes stratégiques du Plan Régional de Développement (PRD)
Principe et cadrage du PRD
Les axes stratégiques
Point fort de la décentralisation
a- le principe d’une entité autonome
b- une bureaucratie réduite
c- une efficacité de gestion
d- une administration à dimension humaine
e- Meilleure fourniture des services
f- Démocratisation local
g- Intégration nationale
h- La Subsidiarité
Chapitre IV : Limite de la décentralisation
Conditions critiques et risques liés à la décentralisation
Dangers pour la fourniture des services
Politiques locales et mauvaise gouvernance
Nouvelles tensions et tendances séparatistes
Les Abus
Finance
Les bons principes pour assurer la mise en œuvre de la décentralisation
Renforcement des capacités au niveau central
Renforcement des capacités au niveau local
Amélioration des collaborations des CTD
Evoluer le transfert de compétences vers les CTD
Améliorer la prestation des services au niveau des CTD
Les capacités managériales, de gestion et de pilotage des CTD sont améliorées
Renforcer les STD au service des CTD
Promouvoir la participation citoyenne et le développement du partenariat
Améliorer le cadre des finances publiques de Madagascar
Les dépenses
Les recettes
Les transferts
L’avenir de la décentralisation à Madagascar
CONCLUSION
LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIES
Télécharger le rapport complet