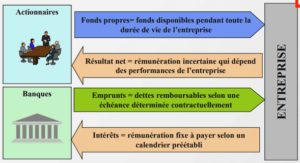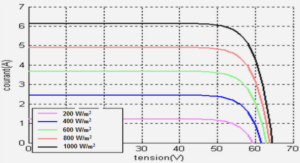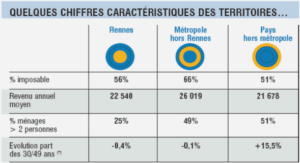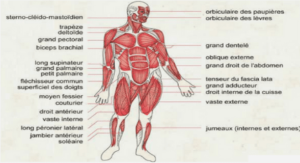Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Généralités sur les infections urinaires
Définitions et diagnostic
Infection et colonisation urinaires
Les sociétés savantes françaises, européennes et américaines s’accordent aujourd’hui pour définir les infections urinaires par l’association d’une bactériurie significative et de symptômes évocateurs d’infection urinaire en l’absence d’autre foyer infectieux [12-14]. Cette association les distingue des colonisations urinaires, qui à l’inverse sont définies par une bactériurie significative sans symptôme associé [13-15]. Selon l’IDSA (Infectious Diseases Society of America), les symptômes et signes cliniques compatibles avec une infection urinaire peuvent être variés, allant de signes fonctionnels urinaires tels que la pollakiurie ou les brûlures mictionnelles, jusqu’à des symptômes aspécifiques comme la fièvre, les frissons, un malaise, un ralentissement psychomoteur, une confusion chez le sujet âgé, ou encore, chez les patients ayant une atteinte de la moelle épinière, une augmentation de la spasticité ou une dysautonomie [12].
Leucocyturie
Le seuil de leucocyturie communément admis comme significativement associé à une infection urinaire est de 104/ml [13, 14]. Cependant, la leucocyturie n’a pas une bonne valeur prédictive de la présence d’une infection urinaire [12-14]. En effet, c’est un marqueur non spécifique d’inflammation des voies urinaires qui peut être rapporté à différentes étiologies, dont les infections urinaires, la présence d’un cathéter urinaire, une vulvo-vaginite, une néphropathie notamment tubulaire, mais également aux simples colonisations urinaires. Dans une étude américaine comportant 761 patients nouvellement cathétérisés, la leucocyturie moyenne était significativement plus élevée chez les 82 patients (10,8%) ayant une bactériurie que chez ceux ayant une culture urinaire stérile (7. 104 vs 4. 103/ml ; p=0,006) [16].
Les bactériuries à entérobactéries sont significativement associées à des taux de leucocyturie plus élevés (1,2. 105 CFU/ml) qu’en cas de bactériurie à staphylocoque coagulase négative, entérocoque (4. 104 CFU/ml), ou levure (2,5. 104 CFU/ml) [16].
L’absence de leucocyturie significative comme critère permettant d’écarter le diagnostic d’infection urinaire est soumise à controverse. Ainsi, dans une revue de la littérature, Wilson et al. estiment la valeur prédictive négative (VPN) d’une leucocyturie (recherchée par dosage de la leucocyte estérase) entre 51% et 99% pour détecter une bactériurie [17]. La valeur prédictive négative est très différente selon le type d’infection urinaire. Par exemple, si elle très élevée dans les cystites simples, elle l’est moins pour les prostatites aigües : Etienne et al. rapportent une VPN entre 57% et 64% dans une population de prostatites aigües bactériennes (proportion de patients sondés non connue) [18]. La leucocyturie peut en effet manquer dans de véritables infections urinaires, notamment chez les patients neutropéniques, lorsque l’ECBU est réalisé trop précocement, ou lorsque les urines ont été étudiées après un délai trop long, les leucocytes ayant pu se lyser dans l’intervalle. Par ailleurs, la valeur prédictive négative des bandelettes urinaires est améliorée par la détection simultanée de la leucocyte estérase et des nitrites, témoignant de la présence d’une nitrate réductase chez la bactérie recherchée [17]. Les entérocoques ne possédant pas de nitrate réductase, la valeur diagnostique de la bandelette urinaire est moindre dans ce type d’infection.
Concentrations bactériennes urinaires
Le seuil de bactériurie significative varie selon que l’infection urinaire est une cystite une pyélonéphrite ou une prostatite, et n’est pas consensuel entre les différentes sociétés savantes. Les recommandations françaises de 2008 définissent différents seuils de concentrations bactériennes urinaires significatives, selon le pouvoir pathogène sur les voies urinaires de la bactérie en cause, le tableau clinique, mais également selon la méthodologie du recueil urinaire. Ainsi, le seuil retenu en cas de recueil standard (2ème jet d’urines) sera 103 UFC/ml pour une cystite à E. coli, à une autre entérobactérie ou à Staphylococcus saprophyticus, 105 UFC/ml pour une cystite à entérocoque, et 104 UFC/ml pour les pyélonéphrites et prostatites [13]. A l’inverse, l’European Association of Urology (EAU) retient les seuils de 103 UFC/ml pour les cystites simples, de 104 UFC/ml pour les pyélonéphrites non compliquées et les prostatites, et de 105 UFC/ml pour les pyélonéphrites compliquées, indépendamment de la bactérie en cause [14]. Lorsque l’ECBU est recueilli par ponction sus-pubienne, la bactériurie est considérée significative quelle que soit son importance [13, 14].
Chez les patients sondés au long cours ou de façon intermittente, ou chez lesquels le cathéter urinaire a été retiré depuis moins de 48 heures, le seuil retenu par l’IDSA est de 103 UFC/ml [12]. Idéalement, l’ECBU chez un patient sondé devrait être réalisé juste après le changement de sonde urinaire, pour minimiser la contamination par les bactéries adhérant à l’intérieur du cathéter [19]. En l’absence de symptômes, les concentrations bactériennes urinaires permettant de retenir le diagnostic de colonisation plutôt que de contamination du prélèvement varient selon les sociétés savantes. Les recommandations françaises utilisent le seuil de 105 UFC/ml pour définir les bactériuries asymptomatiques lors de la grossesse, tandis que la notion de seuil disparaît en dehors de cette condition [13]. L’EAU retient le diagnostic de colonisation urinaire lorsque 2 prélèvements urinaires répétés à > 24 heures d’intervalle retrouvent une même espèce bactérienne à un taux 105 UFC/ml [14]
asymptomatique par un seuil de 103 UFC/ml en cas de recueil par sondage, 105 UFC/ml en cas de recueil standard, en ajoutant la notion de répétition chez les femmes (bactérie isolée identique sur 2 prélèvements consécutifs) [15]. Chez les hommes, la valeur diagnostique d’une bactériurie semble meilleure. Gleckman et al. ont étudié 59 hommes asymptomatiques ayant une culture du 2ème jet urinaire positive à E. coli ³105 UFC/ml. Un nouvel ECBU prélevé 1 semaine plus tard montrait dans 58/59 cas les mêmes résultats [20].
Ces différences traduisent toute la difficulté dan expliquent pourquoi ces seuils doivent toujours être interprétés en fonction des symptômes et du contexte clinique [13, 14].
Une synthèse des recommandations des différentes sociétés savantes concernant le seuil des concentrations bactériennes urinaires significatives dans les infections et colonisations urinaires est proposée dans le tableau 1.
Etiologie des infections urinaires
Létiologie des infections urinaires diffère selon le terrain. Escherichia coli domine lépidémiologie des infections urinaires communautaires. Dans un travail italien récent analysant 13820 prélèvements urinaires communautaires (colonisations et infections), ce pathogène représentait 68% des isolats. Klebsiella pneumoniae (8,8%), Enterococcus faecalis (6,3%), Proteus mirabilis (5,2%), Pseudomonas aeruginosa (2,5%), et Streptococcus agalactiae (2,3%) étaient également isolés [33]. Les auteurs se sont intéressé aux étiologies en fonction de lâge et du sexe des patients et notent que la place dE. coli est beaucoup moins importante chez les hommes ! 60 ans (52,2%) et les enfants » 14 ans (51,3%). A linverse, P. mirabilis est très fréquent chez les garçons » 14 ans (21,2%), et E. faecalis et P. aeruginosa sont des étiologies importantes chez les hommes ! 60 ans (11,6% et 7,8% respectivement).
Lépidémiologie des infections urinaires nosocomiales diffère notablement. Une étude réalisée en 2000 dans 25 pays dEurope estimait leur incidence à 3,55 épisodes /1000 patients-jour et leur prévalence à 10,65/1000 patients [29]. Cent quatre-vingt-sept patients (62,8%) étaient porteurs dun cathéter urinaire et seulement 78,5% dentre eux avaient un système de drainage clos. Les microorganismes les plus rencontrés étaient E. coli (30,6%), Enterococcus spp (14,1%), Candida albicans (12,9%), Klebsiella spp (10%), P. aeruginosa (8,2%), Proteus spp (7,4%), Enterobacter spp (4,1%), et Staphylococcus aureus (3,5%).
Lépidémiologie de la résistance bactérienne est en constante évolution, notamment en lien avec la prescription dantibiotiques. Actuellement, lépidémiologie des infections urinaires est marquée par lémergence de 2 types de situations préoccupantes :
– les souches communautaires dEscherichia coli sécrétrices de #-lactamase à spectre élargi (BLSE), qui sont passées de 1,7% des isolats urinaires communautaires en Grèce entre 2005 et 2007 à 3,5% entre 2008 et 2010 (p=0,0005) [39].
– les infections urinaires nosocomiales, au cours desquelles les pathogènes prédominants (entérobactéries, entérocoques, Pseudomonas aeruginosa) ont des taux de résistance élevés.
En particulier, le pourcentage de résistance à la vancomycine des E. faecium aux Etats-Unis est passé de 0% au début des années 80 à plus de 80% en 2007 [40]. En Europe, en 2007, la résistance à la vancomycine concernait de 1% (pays scandinaves) à > 30% des souches dentérocoques (Grèce, Irelande) [40]. 26
Infections urinaires masculines à entérocoque
Peu détudes permettant de décrire lépidémiologie des infections urinaires masculines à entérocoque ont pu être retrouvées dans les revues référencées dans MedlineÆ. Les données sont le plus souvent issues darticles ne faisant pas la distinction ni entre hommes et femmes, ni entre infections et colonisations urinaires.
Les entérocoques représentent globalement 5 à 10% des infections urinaires de lhomme [6, 9, 10], mais leur fréquence est plus élevée dans certaines circonstances.
Tout dabord, parmi les infections urinaires nosocomiales, la part des entérocoques est plus importante : dans une étude rétrospective française comportant 371 prostatites aigües bactériennes, les entérocoques étaient incriminés dans 16 cas, soit 6% [6], la moitié dentre eux étant dorigine nosocomiale. Lentérocoque était donc responsable de 8/295 prostatites communautaires (4%) et 8/76 prostatites nosocomiales (14%), cette différence nétantcependant pas significative. Un travail canadien réalisé dans différents services de soins intensifs (réanimations médicale, chirurgicale et cardiaque) montrait que lentérocoque représentait 15% (57/356) des bactériuries, plaçant ce pathogène au 3 ème rang après E. Coli et Candida albicans [11]. Les auteurs mentionnaient que plus de 90% des patients avaient une sonde urinaire. Dans cette étude, il nexistait pas dassociation significative en analyse multivariée entre la présence dune infection urinaire et la mortalité, cependant on note quaucune donnée clinique nétait prise en compte, et quune infection urinaire était définie par un critère biologique seul (bactériurie de 1 ou 2 microorganismes ! 105 UFC/ml), ne permettant pas de distinguer les colonisations urinaires des infections.
La part des entérocoques dans les infections nosocomiales semble en augmentation. Kang et al. se sont intéressés à lévolution des pathogènes retrouvés dans les infections nosocomiales entre 1980 et 2008 en Caroline du Nord. La fréquence des entérocoques a augmenté de 3,8% globalement (8,1% en 1980-84, 5,8% en 1985-89, 10,7% en 2005-2008), et surtout dans les infections urinaires, définies dans ce travail par une bactériurie associée à au moins 1 symptôme, ou elles augmentaient de 5,7% en 28 ans [41].
Lentérocoque est également incriminé comme un pathogène potentiel dans les prostatites chroniques. Dans une étude prospective incluant 65 cas de prostatites chroniques diagnostiquées par la présence de leucocytes dans les sécrétions prostatiques associés à une concentration bactérienne ! 103 UFC/ml dans les urines ou les sécrétions prostatiques recueillies après massage prostatique, 16 (22,8%) étaient dues à un entérocoque (2ème rang après E.coli) [42]. Certains auteurs, notamment en Italie, le placent même au 1 er rang des étiologies de prostatite chronique [43, 44].
Dautre part, les entérocoques semblent être particulièrement en cause au cours des infections urinaires survenant chez les transplantés rénaux. Golebiewska et al. ont recueilli1170 ECBU chez 89 transplantés rénaux entre janvier et décembre 2009. Globalement, E. faecium était le pathogène le plus fréquemment retrouvé avec E. coli, et tout particulièrement pendant le 1er mois après la transplantation, où les 3 principales bactéries étaient E. faecium, (n=24, 33%), puis E. coli et E. faecalis [45]. Néanmoins, les auteurs précisent que dans lensemble, 65% des infections urinaires étaient asymptomatiques, et que les épisodes symptomatiques étaient plus importants après le 1er mois de transplantation, précisément au moment où la part des entérocoques diminue. Parmi les 49 patients concernés par une infection urinaire, 33 (67%) ont présenté au moins 2 épisodes (extrême = 8 épisodes chez un même patient). Pour 27 dentre eux (82%), au moins un des épisodes était symptomatique.
Aucun entérocoque nétait rapporté parmi les 5 épisodes durosepsis, définis par un ECBU et une hémoculture positifs au même germe. En analyse multivariée, seul le sexe féminin était significativement associé à la présence dune bactériurie (symptomatique ou non). On note tout de même que les 7 patients ayant une anomalie urologique après transplantation (reflux vésico-urétéral, rétrécissement de la jonction vésico-urétérale) ont présenté des bactériuries récurrentes. Dans cette étude polonaise, les transplantés rénaux ont reçu systématiquement 7 à 10 jours de ceftriaxone en péri-opératoire, ce qui pourrait expliquer en partie la forte proportion dentérocoques observés le 1er mois, cependant, cela nexplique pas la nette prédominance des E. faecium parmi les entérocoques. Par ailleurs, tous les patients ayant un ECBU positif recevaient une antibiothérapie, y compris en cas de bactériurie asymptomatique. Cela pourrait expliquer le faible taux dinfections symptomatiques. Cependant, ces patients ayant déjà eu des épisodes de bactériurie asymptomatique, pourtant traités, ont développé plus dinfections urinaires symptomatiques par la suite que les patients jamais colonisés par le passé, suggérant que le traitement des bactériuries asymptomatiques échouait à prévenir le risque infectieux.
Lloyd et al. ont comparé des patients (hommes et femmes) ayant une bactériurie à entérocoque avec des patients porteurs dun autre pathogène afin de rechercher les facteurs de risque de colonisation urinaire à entérocoque. Ce travail met en évidence quune exposition récente (dans les 30 derniers jours) à une antibiothérapie était plus fréquente chez les patients ayant une infection ou colonisation urinaire à entérocoque (78% vs 41%), cette différence nétant cependant pas statistiquement significative [46].
Infections urinaires associées aux soins
Les infections liées aux soins, sont favorisées par laltération des mécanismes naturels de défense. Elles surviennent majoritairement chez des patients porteurs dun cathéter urinaire. Dans une étude européenne incluant 298 épisodes dinfections urinaires nosocomiales (définies par une bactériurie !105 UFC/ml ou dune fungurie !105 UFC/ml), 62,8% des patients avaient un cathéter urinaire [29]. Le développement dune bactériurie sur sonde se fait par voie endoluminale, (mécanisme nettement moins fréquent depuis lutilisation de systèmes clos) ou extraluminale péri-urétrale tardive, par migration par capillarité le long du cathéter des bactéries de la flore urétrale. La prévalence de la bactériurie augmente avec la durée de cathétérisation, et approche les 100% après 30 jours [49]. Le risque infectieux lors de la pose de la sonde est moindre, de moins de 1% en pathologie communautaire à 20% chez des patients hospitalisés [49]. La présence dun cathéter urinaire contribue également à pérenniser linfection : urothélium endommagé par la sonde urinaire, formation de biofilm bactérien à la surface de la sonde, Enfin, chez le patient sondé, la vidange vésicale nest pas complète, et le résidu urinaire permanent favorise la multiplication bactérienne [2].
Plus rarement, les infections urinaires nosocomiales surviennent après un geste invasif sur les voies urinaires (cystoscopie, geste chirurgical). Dans 20% des infections urinaires nosocomiales, aucun facteur favorisant évident nest retrouvé [2, 29].
Infections urinaires chez lhomme : latteinte prostatique est-elle constante ?
De nombreux éléments incitent à penser que linfection urinaire masculinesaccompagne dune infection prostatique par reflux rétrograde durine infectée dans les canaux prostatiques.
Lexistence dun reflux des urines vers les canaux prostatiques a été suggérée dès 1927, lorsque Thomas et Robert ont mis en évidence une association entre calculs urinaires et prostatiques (incidence élevée -16.4%- de calculs urinaires chez les patients ayant un diagnostic radiologique de calculs prostatiques). Cette hypothèse est supportée par les travaux de Kirby et al. en 1982, dans une série de 3 expériences : dans un premier temps, des particules de carbone ont été injectées à des cadavres par voie suspubienne, jusquà atteindre une pression intravésicale de 50cmH2O, maintenue pendant 20 minutes. Lanalyse macroscopique et microscopique des prostates ensuite réséquées révélait dans tous les cas(n=10) un reflux intracanalaire de carbone (figure 2) [50]. Lexpérience a ensuite été reproduite chez 10 hommes qui allaient avoir une prostatectomie : après instillation par cathéterisme vésical rétrograde des particules de carbone et miction des patients, ceux-ci étaient opérés. Pour 7 dentre eux (70%), lanalyse histologique objectivait du carbone dans les canaux prostatiques. Enfin, cette manuvre était répétée chez 5 patients souffrant de prostatite chronique abactérienne ; 72 heures après linstillation, un massage prostatique était réalisé. Les sécrétions recueillies contenaient de nombreux macrophages ayant phagocyté les particules de carbone.
Dans un modèle expérimental de prostatite à E. coli chez des rats infectés par voie ascendante, Nickel et al. ont montré quà la phase de prostatite aigüe, les acini et les canaux excréteurs contiennent de nombreux polynucléaires et bactéries [51]. Létude anatomopathologique à la phase de prostatite chronique retrouve les bactéries et les polynucléaires en nombre moins élevé, mais toujours présents au niveau des acini et des 32 canaux excréteurs. Lespace interstitiel est à ce stade envahi de tissu fibreux et dun infiltrat lymphocytaire. Le site primaire de linfection semble donc être les sécrétions prostatiques dans la lumière des acini plutôt que lespace interstitiel, confortant lhypothèse dune infection par voie rétrograde.
Des arguments radiologiques confortent lhypothèse dune atteinte prostatique fréquente : en effet, Ulleryd et al. ont montré que la majorité des hommes présentant une prostatite aigüe diagnostiquée par une température ! 38°C, des signes fonctionnels urinaires et une culture urinaire positive, avaient un volume prostatique augmenté en phase aigüe, témoignant dune inflammation glandulaire [24]. Parmi les 67 patients, 55 ont eu une échographie prostatique par voie transrectale comparative à 3 mois dintervalle : après traitement antibiotique, une diminution significative du volume prostatique médian était alors observée, passant de 49 ml [14-104 ml] à 35 ml [15-91 ml] (p<0,001). Les auteurs ont également étudié lévolution des PSA chez les 70 patients inclus. Le taux initial était élevé dans 58/70 cas (83%). Parmi les 55 patients ayant un 2ème dosage à 3 mois, 51 (soit 93%) avaient une diminution du taux de PSA > 25%. Considérant quune diminution du taux de PSA > 25% à 3 mois ou une diminution du volume prostatique > 10% à 3 mois signaient une atteinte prostatique initiale, les auteurs concluaient que 94% des hommes (46/49 patients ayant un dosage de PSA et une échographie à 3 mois) avaient une prostatite associée.
Les auteurs dune étude portant sur lintérêt de la scintigraphie aux leucocytes marqués par lIndium dans les prostatites aigües semblent au contraire décrire des cas dinfections urinaires masculines sans prostatite associée [52]. En effet, 10 patients ayant une prostatite aigüe clinique (fièvre, sensibilité au toucher prostatique, leucocyturie) avaient une absorption prostatique des leucocytes en phase aigüe, qui disparaissait dans 9/10 cas après le traitement, et diminuait nettement dans le dernier cas. A linverse, 5 autres patients dont la prostate était indolore au toucher rectal navaient pas de fixation prostatique mais une fixation au niveau rénal. Une seconde étude utilisant la scintigraphie aux leucocytes marqués par l’Indium montrait une atteinte associée de la prostate chez deux tiers des hommes ayant uneinfection urinaire, même lorsque le tableau clinique initial évoquait une pyélonéphrite aigüe (fièvre, leucocyturie et douleur lombaire sans douleur au toucher rectal) [53]
Généralités sur les entérocoques
Caractéristiques bactériologiques
Les entérocoques sont des cocci à Gram positif, anaérobies facultatifs. Longtemps classés au sein du genre Streptococcus, ils sont très proches morphologiquement des streptocoques. En effet, ils prennent typiquement le même aspect de diplocoques ou de courtes chainettes. Leur morphologie ne permet donc pas de les distinguer avec certitude dautres genres de la famille des Streptococcaceae, en particulier les genres Leuconostoc, Pediococcus, et Peptostreptococcus. Les entérocoques appartiennent généralement aux streptocoques du groupe D selon la classification de Lancefield, qui distingue les streptocoques selon leurs antigènes de paroi [61]. Avec lapparition des techniques debiologie moléculaire, dimportantes différences par rapport aux autres streptocoques ont été découvertes, conduisant à individualiser le genre Enterococcus en 1984 [62].
Au sein de ce genre, il existe plus de 27 espèces, dont 2 dominent largement en pathologie humaine : E. faecalis (85-90% des infections), et E. faecium (5-10%). Les autres espèces, bien que parfois rencontrées, sont marginales en pratique clinique. Il sagit par exemple dE. gallinarum, E. hirae, E. casseliflavus, E. avium, E. durans, E. raffinosus, ou encore E. flavescens [63, 64].
Malgré quelques exceptions, les entérocoques sont capables de survivre à des conditions hostiles : culture à 10°C et 40°C, voire même survie à 60°C pendant au moins 30 minutes, mais aussi en présence de 40% de bile, à pH= 9,6 ou en présence de NaCl à 6,5%(propriété halophile). Ils ne produisent généralement pas de catalase, sont capables dhydrolyser la L-pyrrolidonyl-3-naphthylamide (PYR) [65] et lesculine, cette dernièrepropriété étant liée à la présence dune #-glucosidase. Cette enzyme est à lorigine de la formation de colonies vertes sur géloses CPSÆ (bioMérieux) (figure 4). La capacité des entérocoques à se multiplier en présence de bile et à hydrolyser lesculine explique la formation dun halo noir autour des colonies sur gélose bile-esculine. Cependant, ces propriétés sont également présentes chez les streptocoques du groupe D comme S. gallolyticus et S. equinus. Les entérocoques sont généralement $- ou non-hémolytiques, mais certaines espèces peuvent être #-hémolytiques selon les conditions de culture (figure 5) [66]
|
Table des matières
LE DES MATIERES
INTRODUCTION
DONNEES DE LA LITTERATURE
A. Généralités sur les infections urinaires
B. Généralités sur les entérocoques
C. Traitement des infections urinaires à entérocoque
PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS DE LETUDE
MATERIEL ET METHODES
A. Les patients
B. Analyse microbiologique
RESULTATS
A. Données cliniques
B. Données paracliniques
C. Données microbiologiques
D. Traitement et évolution
E. Comparaison entre infections et colonisations urinaires
DISCUSSION
CONCLUSION
ANNEXES
REFERENCES
Télécharger le rapport complet